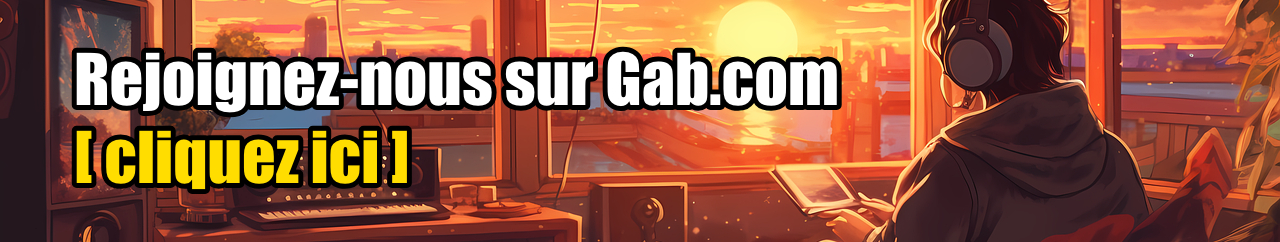La Rédaction
Démocratie Participative
\n23 mai 2025

Hier, j’évoquais la fin inéluctable des États-Unis d’Amérique en dépit de la hype artificielle autour de Trump, hype savamment entretenue par la droite démocratique sous nos propres latitudes.
À cette occasion, j’ai évoqué la lutte de la Confédération pour la survie de la race blanche en Amérique du Nord, en particulier un discours essentiel d’Alexander Stephens sur la raison d’être de la cause sudiste : sauver la race blanche.
Je veux développer plus avant ce sujet, car le séparatisme raciste sera indiscutablement le grand phénomène politique du 21e siècle en Europe et la sécession confédérée fut, à bien des égards, un combat du même ordre que celui de l’Allemagne NS : un combat pour la race blanche et la liberté.
Sur les 33 états que comptait l’Union en 1860, 11 firent sécession sur une période de cinq mois, de décembre 1860 à mai 1861 . Quoique minoritaires, ils n’étaient pas des moindres : le glorieux Texas, par exemple, rejoignit la Confédération le 1er février 1861.
- Caroline du Sud (20 décembre 1860)
- Mississippi (9 janvier 1861)
- Floride (10 janvier 1861)
- Alabama (11 janvier 1861)
- Géorgie (19 janvier 1861)
- Louisiane (26 janvier 1861)
- Texas (1er février 1861)
- Virginie (17 avril 1861)
- Arkansas (6 mai 1861)
- Tennessee (6 mai 1861)
- Caroline du Nord (20 mai 1861)
En 1860, les États-Unis comptaient 31,4 millions d’habitants. Après la sécession, les états confédérés en comptaient 9,1 millions (Blancs et Noirs), soit 29% de la population totale des USA, mais il faut souligner que sur ces 9,1 millions, les Blancs représentaient 5,6 millions d’habitants.
S’interdisant d’enrôler les Noirs dans l’armée, la Confédération devra généralement combattre à un contre deux les armées yankees, compensant le déficit en hommes, en armes, en munitions par une détermination farouche, une haute conscience des enjeux historiques, un matériel humain de grande qualité, en particulier ses chefs.
J’ai d’instinct, et depuis l’enfance, toujours préféré les tuniques grises aux tuniques bleues, parce que ces deux couleurs résument à elles seules toute la différence entre les conceptions qui s’affrontaient, et la supériorité esthétique naturelle — et révélatrice — que ce contraste visuel trahissait.
L’insistance — au nom d’une morale étouffante, lancinante, vicieuse — de toute la littérature officielle à vouloir me faire aimer les tuniques bleues me les a rendues très vite vomitives, et les tuniques grises d’autant plus héroïques.
Pour en revenir à la Confédération, le déséquilibre démographique était encore aggravé par le fossé économique béant qui séparait le Sud au Nord.
Le Nord pesait approximativement 75% de l’économie américaine globale. Il disposait des deux tiers des voies ferrées, un avantage capital pour les mouvements de troupes et de matériels, et contrôlait 90% de la production manufacturière, un avantage crucial pour la production de guerre. La Confédération ne produisait quant à elle que 5% des armes à feu américaines, l’obligeant à importer ou capturer les armes dont elle avait besoin. Enfin, la Confédération n’avait aucune flotte de guerre, l’exposant au blocus naval du Nord.
Si le Sud pouvait mobiliser théoriquement un million de soldats, le Nord disposait de 4 millions d’hommes en mesure d’être mobilisés. Au plus fort de la guerre, la Confédération alignera une armée de 900 000 hommes, soit 80% des hommes blancs en âge de combattre. Face à elle, les Yankees aligneront 2,1 millions de soldats, dont 180 000 Noirs recrutés afin de mener une guerre d’écrasement racial contre le Sud.
Ce déséquilibre écrasant ne dissuada pas les hommes blancs du Sud de résister à Washington et à la finance newyorkaise, progressivement rongés par une virulente fièvre antiraciste. À Washington comme dans la presse du Nord, démocratie et christianisme protestant se mêlaient dans une même utopie égalitaire dont l’opposition à l’esclavage était devenue l’obsession.
Pour les états du Sud, c’est l’élection de Lincoln, un farouche abolitionniste, qui précipita la guerre. L’abolition de l’esclavage signifiait une marginalisation économique aggravée du Sud agricole au profit du Nord industriel, mais aussi une attaque directe du gouvernement central contre les droits des états. Elle impliquait également une remise en cause beaucoup plus fondamentale : la croyance obligatoire, contre l’expérience, en l’égalité des races.
Les déclarations de sécession des différents états affirmèrent progressivement une prise de conscience raciale des enjeux.
Déclaration de sécession de la Caroline du Sud, le 24 décembre 1860 :
Une hostilité croissante de la part des États non esclavagistes envers l’institution de l’esclavage a conduit à un mépris de leurs obligations constitutionnelles. […] Les États du Nord ont assumé le droit de décider de la propriété de nos esclaves et de nier les droits que nous possédons en tant que propriétaires.
Déclaration de sécession de la Géorgie (29 janvier 1861) :
« La question de l’esclavage est la grande cause de cette séparation. […] Pendant les quarante dernières années, la répugnance du peuple non esclavagiste à l’institution de l’esclavage s’est accrue ; et cette répugnance a atteint un point où ils ne sont plus disposés à respecter les droits constitutionnels du Sud. »
C’est toutefois la déclaration de sécession du Texas, le 2 février 1861, qui formula explicitement la nature raciale de la guerre :
« [Le Texas] a été reçu comme un corps politique tenant, maintenant et protégeant l’institution connue sous le nom d’esclavage nègre – la servitude de la race africaine envers la race blanche dans ses limites – une relation qui existait depuis le premier peuplement de son désert par la race blanche, et que son peuple entendait voir exister à tout jamais. […] Les États non esclavagistes ont proclamé la doctrine dégradante de l’égalité de tous les hommes, sans distinction de race ou de couleur – une doctrine en guerre avec la nature, en opposition avec l’expérience de l’humanité, et en violation des révélations les plus claires de la loi divine. »
Après l’annonce par le Nord du recrutement de soldats noirs, le président de la Confédération, Jefferson Davis, signa un décret le 23 décembre 1862 ordonnant que ceux-ci soient traités comme des esclaves en fuite par les armées sudistes, c’est-à-dire exécutés sur le champ.
En février 1863, Jefferson Davis signa un nouveau décret qui restaurait l’esclavage pour les Noirs libres du Sud.
Le 29 décembre 1864, alors que le Sud était à quelques mois de la défaite finale, le président Davis refusa la mobilisation des Noirs dans l’armée sudiste en échange de leur libération :
« Accorder la liberté à l’esclave en échange de son service militaire serait une admission que notre cause est fausse, car elle repose sur l’idée que la race africaine est naturellement subordonnée à la race blanche. »
Ces actes officiels étaient l’expression politique d’une volonté plus large de la société sudiste.
En février 1861, Howell Cobb, président du comité de rédaction de la nouvelle constitution de la Confédération, exprima la fondation raciale de celle-ci :
« La suprématie de la race blanche est le principe sur lequel repose notre société. Sans l’esclavage, qui maintient le nègre dans sa juste position, notre civilisation s’effondrerait. »
Comment ne pas voir la justesse de ce propos.
Black twerk culture is truly disgusting. pic.twitter.com/9oYT0gMfs3
— White Ghost (@White_Ghost187) April 30, 2025
Opposant à l’élection de Lincoln, le sénateur de la Géorgie Robert Toombs déclara dans son dernier discours au Sénat, avant le début de la guerre :
Nous ne voulons pas de l’égalité des Noirs, ni de la citoyenneté des Noirs ; nous ne voulons pas que la race des Noirs dégrade la nôtre ; et comme un seul homme, nous vous rencontrerons à la frontière avec l’épée dans une main et la torche dans l’autre.

Robert Toombs
À la veille de la sécession, Lawrence M. Keitt, député de la Caroline du Sud déclara :
L’esclavage est le rempart de la civilisation blanche dans le Sud. Sans lui, la race blanche serait submergée par l’infériorité du nègre. Nous nous battrons pour préserver cette institution et notre suprématie.
Dès le début, la presse des états confédérés mobilisa également les quelques 6 millions de Blancs face aux assauts de la démocratie nordiste.
Un éditorial de J.D.B. De Bow dans la De Bow’s Review, daté de 1860, prophétise l’effondrement de la race blanche en Amérique si l’esclavage venait à être aboli :
Le Sud combat pour maintenir la civilisation blanche, qui repose sur l’esclavage du nègre. Sans cette institution, la race blanche perdrait sa domination et sombrerait dans le chaos.
L’éditorial du Richmond Enquirer du 15 janvier 1861 expose la nature raciale de la guerre dès les premières semaines du mouvement sécessionniste :
Le Sud se bat pour préserver sa civilisation, qui repose sur la subordination de la race africaine à la race blanche. L’égalité raciale prônée par le Nord est une abomination qui menace notre existence.
Le Charleston Mercury, de la Caroline du Sud, publie quelques semaines plus tôt, le 20 décembre 1860, un éditorial justifiant la sécession pour les mêmes motifs :
Nous avons agi pour protéger notre institution particulière, qui garantit la suprématie de la race blanche et la subordination du nègre. La guerre, si elle vient, sera pour défendre cet ordre sacré.
Le Savannah Morning News publie un article le 23 avril 1863 en faveur de l’adoption par la Confédération d’un drapeau racial :
Nous combattons pour maintenir la suprématie ordonnée par le Ciel de l’homme blanc sur la race inférieure ou colorée ; un drapeau blanc serait ainsi emblématique de notre cause.
Le mouvement sécessioniste témoignait d’une puissante conscience raciale et historique, appréhendant pleinement les conséquences inévitables d’une victoire du Nord, mais il croyait naïvement que la démocratie pouvait être bornée à la race blanche. Il ne comprenait pas la dynamique égalitaire du système fondé par Georges Washington.
Après la défaite de la Confédération, en 1865, l’État fédéral nordiste entreprit le démantèlement des structures gouvernementales du pouvoir blanc du Sud dans le cadre de ce qu’il appela, non sans ironie, la “Reconstruction”. Celle-ci préfigurait la “dénazification” de l’Allemagne en 1945.
S’étalant sur 11 ans, de 1865 à 1877, les 11 états du Sud furent placés sous administration militaire, comme un pays étranger vaincu.

Une brutale campagne antiraciste fut initiée avec l’abolition de l’esclavage, la création d’écoles pour les Noirs et la promotion de l’égalité civique au prétexte de l’égalité raciale tandis que près de 150 000 soldats confédérés furent privés de droits politiques.
En 1870, avec l’adoption du 15e amendement permettant le droit de vote sans regard pour la race, des millions de nègres furent pris en charge par Washington afin de les faire voter en faveur du Parti républicain, vainqueur de la guerre, et ainsi consolider son influence dans le Sud vaincu et occupé.
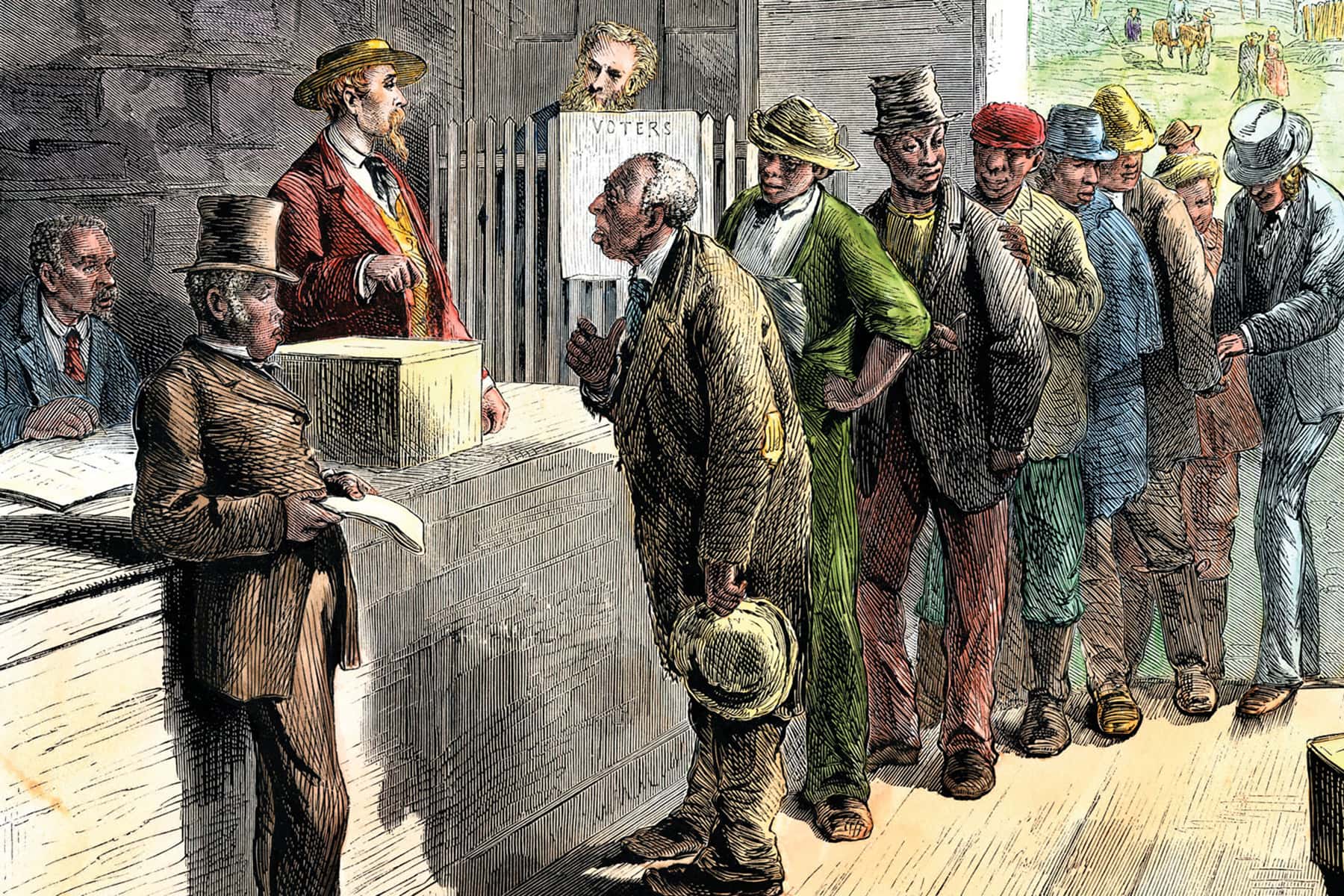
Défendus par un corps expéditionnaire de près de 20 000 soldats nordistes, dont un certain nombre de nègres, les Noirs libérés du Sud purent se livrer à toutes sortes d’exactions dans l’immédiat après-guerre sans craindre de représailles. La presse, mais également les nouvelles autorités, en fit état.
Le journal Richmond Enquirer, le 12 août 1865, évoqua ainsi le cas d’une femme blanche violée par un Noir récemment libéré dans le comté de Henrico, en Virginie.
Un rapport transmis en 1866 à l’autorité militaire d’occupation, le Joint Committee on Reconstruction, mentionne le cas d’un viol commis par un Noir libéré dans une plantation de la paroisse de Saint-Landry sur une femme blanche en 1865. Le coupable fut lynché avant qu’une enquête ne puisse avoir lieu.
Un bureau chargé de superviser la libération des Noirs des états confédérés fut créé. Ses fonctionnaires, quoique zélés partisans nordistes, devaient régulièrement traiter des affaires criminelles consécutives à ce processus. Dans un rapport d’un agent du Freedmen’s Bureau à Mobile, dans l’Alabama, daté de septembre 1865, un agent rapporte l’arrestation d’un Noir libéré, décrit comme un ouvrier agricole, pour le viol d’une femme blanche dans une ferme à la périphérie de la ville de Mobile (National Archives, Record Group 105, Records of the Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, Mobile Sub-District).
Face à cette violence raciale, les nombreux soldats confédérés démobilisés durent s’organiser en milices clandestines qui rapidement s’agrégèrent dans ce qui devint le Ku Klux Klan.

Klansman
Le Klan fut fondé le 24 décembre 1865, Pulaski (Tennessee) par six vétérans des armées confédérées : John C. Lester, John B. Kennedy, James R. Crowe, Frank O. McCord, Richard R. Reed et Calvin Jones. Simple club informel à ses débuts, le Klan se contenta d’abord de rétablir l’ordre racial dans les campagnes lors de chevauchées nocturnes où les Noirs trop agités étaient intimidés.
La politique de “Reconstruction” brutale dictée par le Nord précipita la croissance exponentielle de l’organisation qui atteignit 550 000 membres en 1869. La convention de Nashville, en 1867, définit un véritable programme politique où la lutte raciale se déclinait en objectifs concrets : empêcher que les nègres n’interfèrent dans les élections, neutraliser les agitateurs pro-nègres venus du Nord, faire barrage à toutes les entreprises nordistes pour mettre au pas la société blanche sudiste.
Grâce à l’afflux d’officiers sudistes fraîchement démobilisés, compétents et éprouvés, mais aussi grâce au soutien massif de la population blanche des anciens états confédérés, le Klan se transforma en une organisation politique et paramilitaire déterminée à reprendre le contrôle effectif du territoire et faire ainsi pièce aux “carpetbaggers”, les sicaires envoyés par Washington pour mener la révolution raciale.
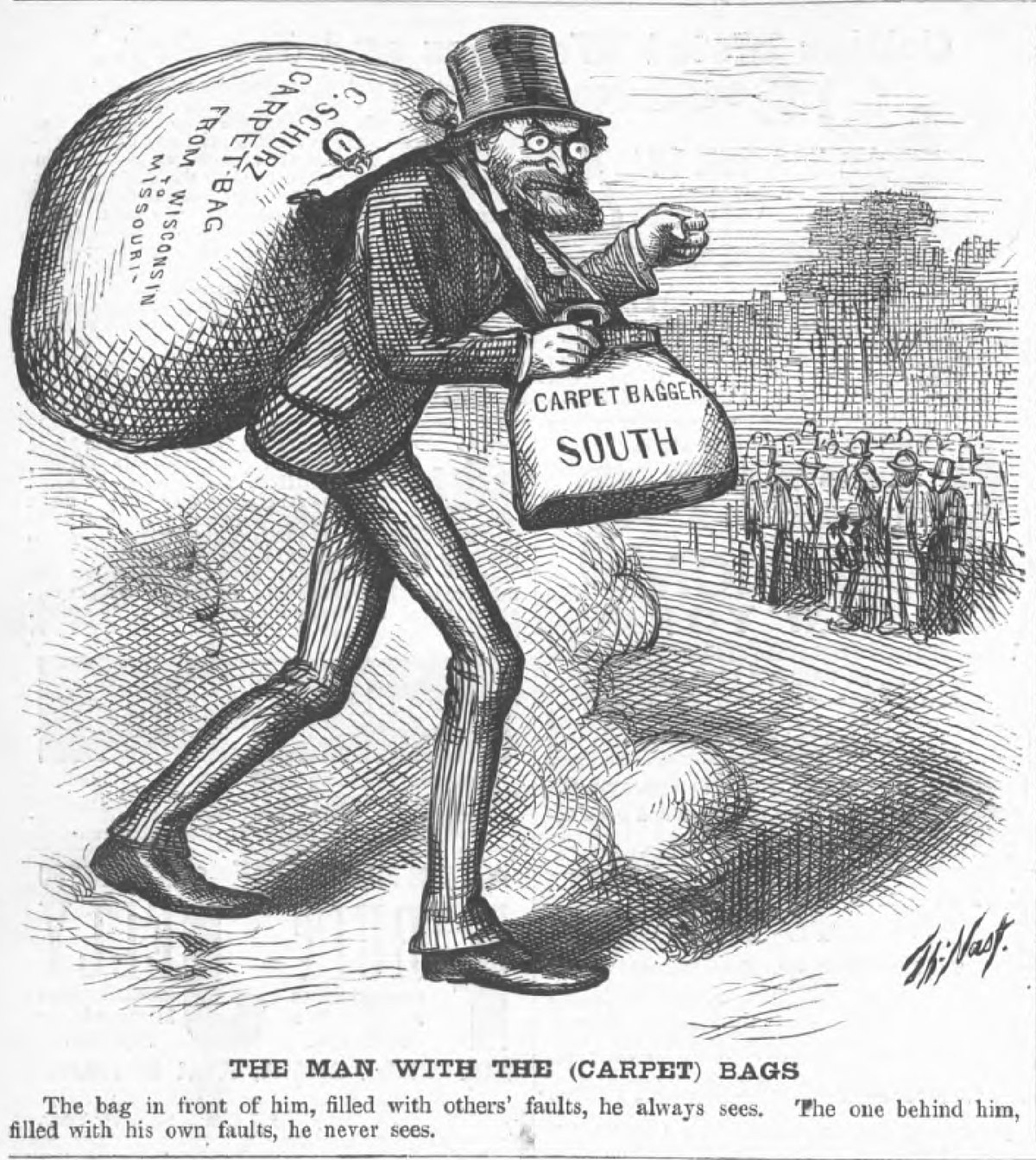
Carpetbagger
Très vite, des milliers de nègres et d’agitateurs blancs furent éliminés à travers les états sudistes.
Un exemple fameux illustre cette résistance raciale. En 1873, à Colfax, en Louisiane, un démagogue nègre très en verve sur la fin prochaine de l’homme blanc, avait convaincu une bande de noirs de se retrancher dans le palais de justice de la ville pour y asseoir le nouvel ordre des choses. Ce fut sans compter sur l’intervention de 300 cavaliers sudistes, dont un certain nombre de membres du Klan. Le bilan, disputé, fait état de 60 à 150 nègres tués en une journée.
Le carnage fit très forte impression sur les nègres de Louisiane qui comprirent qu’en cas de confrontation organisée, l’homme blanc était un adversaire hors de portée. Dans la région, les nègres furent durablement disciplinés.
Le Klan n’était pas la seule organisation blanche à opérer.
La White man’s league (Ligue de l’homme blanc), fondée en 1874, entreprit elle aussi de mener la guérilla raciale. Composée de vétérans des armées du Sud, bien armés et très expérimentés, la League frappait vite et fort, de préférence dans les zones rurales, et ne laissant jamais à ses cibles la possibilité de s’échapper.

Alliance entre le Klan et la League
En 1874, à la Nouvelle Orléans, les nouvelles autorités instituées par Washington tentèrent d’intercepter une livraison d’armes à destination de la League. Plus de 5 000 membres de la League convergèrent sur la ville dont la mairie était défendue par la toute nouvelle police locale, très fortement composée de Noirs. En quelques minutes, les Noirs furent écrasés et le siège du gouverneur placé sous contrôle des patriotes.
Le gouvernement fédéral, ne pouvant compter sur les Noirs qu’il avait armés, fit appel à l’armée pour écraser la League. Face aux milliers de soldats mobilisés, la League fut finalement obligée de se replier aux termes d’une négociation leur accordant l’amnistie.

Cette époque est narrée par le film Birth of a Nation, de David Wark Griffith. Sorti en 1915, considéré comme un chef d’oeuvre du cinéma américain et mondial, le film, résolument pro-sudiste, a précipité la résurgence du Klan au 20e siècle.
Les juifs ont très vite compris que la lutte contre le Sud, sa cause, son empreinte culturelle et mémorielle, était primordiale pour asseoir leur domination spirituelle sur l’Amérique et parachever sa submersion raciale.
Ils furent à l’avant-garde du démantèlement des derniers éléments de la civilisation blanche des états confédérés à la faveur l’agitation pour “les droits civiques” des nègres dans ces états.
Obliger le mélange racial à outrance était leur principe.
Provenant généralement de New York, affiliés au Parti communiste (intégralement juif) dont Martin Luther King était un agent, les juifs déferlèrent dans le Sud à partir des années 1960 pour exiger le démantèlement des dernières barrières de protection raciale en vigueur.
C’est ainsi que les juifs créèrent le mythe Rosa Parks, cette négresse qui voulait s’asseoir à la place des Blancs dans un bus légitimement ségrégué, dont le nom affuble désormais nombre d’établissements scolaires français situés dans les zones racialement ravagées du pays.

C’est que le destin de la Confédération, central dans la construction identitaire et politique de l’Amérique, affecte mécaniquement, par le poids de l’empire américain, l’ensemble des périphéries du système démocratique international, tout comme le destin de l’Allemagne nationale-socaliste a façonné l’Occident après 1945.

La guerre au Sud n’est pas finie, comme celle qui est faite à l’Allemagne nationale-socialiste n’est pas finie.
La guerre juive à la Confédération, 160 ans après sa défaite, continue en Amérique. Lorsque le Noir (proxénète, drogué, cardiaque) George Floyd est mort, les juifs ont lâché contre le monde blanc l’une de leurs plus violentes offensives politiques et psychologiques de l’histoire récente.
Prétexte au démantèlement des statues célébrant la Confédération, notamment celle du Général Lee, les médias juifs ont méthodiquement mis en scène la mort symbolique de l’homme blanc.
La statue de Robert E. Lee à Charlottesville a connu sa fin, dans un four à 2 250 degrés.
Le monument confédéré qui sème la discorde, au centre du rassemblement meurtrier « Unite the Right » en 2017, a été secrètement fondu et deviendra une nouvelle œuvre d’art public.
Plus d’informations sur le processus :
Charlottesville’s Robert E. Lee statue has met its end, in a 2,250-degree furnace.
The divisive Confederate monument, the focus of the deadly “Unite the Right” rally in 2017, was secretly melted down and will become a new piece of public art.
More on the process:… pic.twitter.com/XatZUfvku3
— The Washington Post (@washingtonpost) October 26, 2023
Plus récemment, les défenseurs de la statue ont tenté d’empêcher la ville de céder Lee au musée de l’histoire des Noirs de Charlottesville, qui avait proposé un plan de réaffectation du métal. Dans un procès, ces plaignants ont suggéré que le monument reste intact ou qu’il soit transformé en canons de la guerre de Sécession.
Mais samedi, le musée a poursuivi son projet en secret dans cette petite fonderie du Sud, dans une ville et un État que le Washington Post a accepté de ne pas nommer en raison des craintes de violence des participants.
The statue’s defenders more recently sought to block the city from handing over Lee to the Charlottesville’s Black history museum, which had proposed a plan to repurpose the metal. In a lawsuit, those plaintiffs suggested the monument should remain intact or be turned into Civil… pic.twitter.com/D80282TZYv
— The Washington Post (@washingtonpost) October 26, 2023
Ces scènes faisaient suite à un intense travail de propagande par les studios juifs d’Hollywood. Il est impossible de trouver un film célébrant la cause du Sud, ni même susceptible de nuance. Celui-ci est invariablement dépeint de la manière dont est dépeint le Troisième Reich : il est l’incarnation du mal.
On ne compte plus les productions où la croisade antiraciste du Nord contre l’homme blanc est célébrée.
- The Charge of the Light Brigade (1936), Michael Curtiz
Bien que principalement centré sur un contexte international, ce film inclut des références à la guerre de Sécession et valorise les idéaux nordistes à travers des personnages soutenant l’Union. - Young Mr. Lincoln (1939), John Ford
Biographie romancée des jeunes années d’Abraham Lincoln, mettant en avant son intégrité et son opposition à l’injustice, préfigurant son rôle dans la cause nordiste. - The Red Badge of Courage (1951), John Huston
Adaptation du roman de Stephen Crane, centrée sur un jeune soldat nordiste confronté à la peur et au courage lors de la guerre de Sécession, valorisant l’expérience des troupes de l’Union. - The Horse Soldiers (1959), John Ford
Western basé sur le raid de Grierson, une opération nordiste visant à saboter les chemins de fer confédérés, mettant en avant le courage et la stratégie des forces de l’Union. - The Great Locomotive Chase (1956), Francis D. Lyon
Basé sur l’opération nordiste du raid d’Andrews (1862), où des soldats de l’Union infiltrent les lignes sudistes pour saboter une voie ferrée, célébrant leur bravoure. - The Raid (1954), Hugo Fregonese
Inspiré d’une histoire vraie, ce film suit un groupe de prisonniers confédérés évadés planifiant des raids contre l’Union, mais il met en avant la résilience des forces nordistes face à ces menaces. - The Band of Angels (1957), Raoul Walsh
Bien que centré sur une romance, ce film aborde la question de l’esclavage et soutient implicitement la cause abolitionniste de l’Union à travers ses thèmes. - Glory (1989), Edward Zwick
Film emblématique sur le 54e régiment du Massachusetts, une unité nordiste composée de soldats afro-américains, célébrant leur courage et la lutte pour l’abolition. - Gettysburg (1993), Ronald F. Maxwell
Centré sur la bataille de Gettysburg (1863), ce film met en avant la victoire décisive de l’Union, avec un accent sur les figures nordistes comme Joshua Chamberlain. - Sommersby (1993), Jon Amiel
Remake du Retour de Martin Guerre transposé dans le contexte post-guerre de Sécession, ce film montre la reconstruction sous l’égide de l’Union et aborde les tensions raciales avec une perspective pro-nordiste. - Andersonville (1996), John Frankenheimer
Téléfilm sur le camp de prisonniers confédéré d’Andersonville, mettant en lumière les souffrances des soldats nordistes capturés et critiquant implicitement la Confédération. - Lincoln (2012), Steven Spielberg
Biographie centrée sur les derniers mois de la vie d’Abraham Lincoln, mettant en avant son combat pour l’adoption du 13e amendement abolissant l’esclavage. - 12 Years a Slave (2013), Steve McQueen
Récit de Solomon Northup, un homme libre kidnappé et réduit en esclavage, ce film soutient fortement la cause abolitionniste de l’Union en exposant les horreurs de l’esclavage. - Free State of Jones (2016), Gary Ross
Basé sur l’histoire vraie de Newton Knight, un déserteur confédéré qui forme une milice pro-Union dans le Mississippi, soutenant l’abolition et l’égalité raciale.
Plus ou moins subtilement, certains films accablent le Sud ou certains de ses héros comme John Wilkes Booth, qui assassina Lincoln pour venger le Sud.
Dans La ligne de mire (1993), une analogie est faite entre Booth et un tueur de la CIA, Mitch Leary (John Malkovich), qui veut assassiner le président des États-Unis pour se venger du cynisme des politiciens. Un vétéran de la sécurité présidentielle (Clint Eastwood), rongé par le remord pour avoir échoué à déjouer l’assassinat de John F. Kennedy, tente de stopper le tueur.
Leary est dépeint sous les traits d’un sociopathe, associé subliminalement à Booth et au Vieux Sud, incarnant le Mal déguisé sous un vernis de patriotisme qui s’en prend à la juste démocratie américaine.
Un exemple subtil de cette manipulation est l’enchaînement de deux scènes.
La première, légère, se conclut avec l’agent de la sécurité présidentielle s’adressant à Lincoln sur un ton amusé : “J’aurais aimé être là pour toi, mon pote.”

La seconde scène débute avec l’apparition de “Booth”, qui s’apprête à assassiner une femme ordinaire qui est devenue contre son gré un témoin compromettant.

Cette mise en scène manichéenne, de facture typiquement démocratique, contribue, année après année, film après film, à façonner la perception de la réalité historique du Sud par le public, notamment blanc, et, par association, de la cause blanche en général.
Vous pouvez visionner le film gratuitement ici.
L’histoire de la Confédération est d’une complète actualité : les causes raciales qui l’ont précipitée menacent aujourd’hui l’ensemble des pays d’Europe de l’Ouest, d’Amérique du Nord, et d’Océanie.
Le séparatisme et la formation d’états nouveaux, conçus pour la préservation de l’intégrité biologique des peuples blancs, est inéluctable, tout comme était inéluctable la sécession des états sudistes dans les conditions historiques qui étaient les leurs.
Aucune invocation lénifiante, et pathétique, des formules politiques du 18e siècle, à commencer par l’état-nation démocratique, ne sera en mesure de répondre à ce bouleversement racial aux allures de révolution mondiale.
Le fanatisme démocratique, juché sur la même croyance idolâtre en l’égalité raciale, rendu arrogant par la prolifération démographique des races inférieures qu’elle alimente, veut parachever à l’échelle du monde blanc ce qu’elle a réalisé dans le Sud.
Aux Blancs d’être prêts car au terme de cette guerre, d’essence religieuse comme le disait fort justement Alexander Stephens, vice-président de la Confédération, il n’y aura pas de prisonniers.

 Démocratie Participative Le site le plus censuré d'Europe
Démocratie Participative Le site le plus censuré d'Europe